cinéma
carnet
de
Politique des auteurs
« Ali Baba et la "Politique des auteurs" »
François Truffaut
Cahiers du Cinéma, numéro 44, février 1955
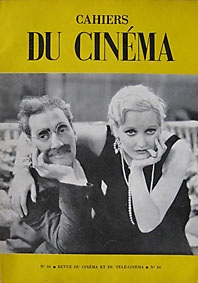
« D’Ali Baba se dégage un charme, mieux : une emprise charmeuse que les plus loués des films français de cette année n'ont pu me procurer.
Ali Baba eut-il été raté que je l'eusse quand même défendu en vertu de la Politique des Auteurs que mes congénères en critique et moi-même pratiquons. Toute basée sur la belle formule de Giraudoux : "il n'y a pas d'œuvres, il n'y a que des auteurs” elle consiste à nier l'axiome, chers à nos aînés selon quoi il en va des films comme des mayonnaises, cela se rate ou se réussit.
De fil en aiguille, ils en arrivèrent — nos aînés — à parler, sans rien perdre de leur gravité, du vieillissement stérilisateur voire du gâtisme d'Abel Gance, Fritz Lang, Hitchcock, Hawks, Rossellini et même Jean Renoir en son hollywoodienne période.
En dépit de son scénario trituré par dix ou douze personnes, dix ou douze personnes de trop excepté Becker, Ali Baba est le film d'un auteur, un auteur parvenu à une maîtrise exceptionnelle, un auteur de films. Ainsi la réussite technique d’Ali Baba confirme le bien-fondé de notre politique, la Politique des Auteurs. »
« Ali Baba et la "Politique des Auteurs” » sur Ali Baba et les quarante voleurs de Jacques Becker par François Truffaut
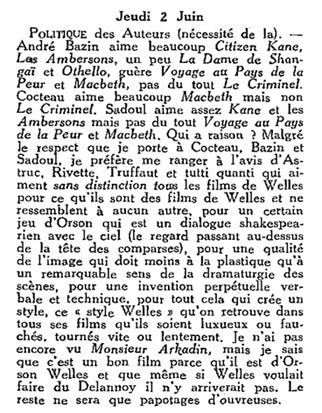
« Petit journal intime du Cinéma », Robert Lachenay (François Truffaut)
Cahiers du Cinéma, numéro 48, juin 1955
La politique des auteurs. Entretiens avec dix cinéastes
Cahiers du Cinéma, 1972

« C'est dans ce paysage qu'éclata, vers le milieu des années cinquante, sous la plume des Truffaut, Rohmer, Chabrol. Godard et Rivette, la scandaleuse "politique des auteurs". Quatre noms et deux initiales sont ses emblèmes : les deux R : Renoir et Rossellini et les deux H américains : Hawks et Hitchcock. Mais le scandale, d'emblée, est triple. Il y eut toujours trois façons au moins de dire "non" à la politique des auteurs. »
Les scandalisés du premier type voient mal. de toutes façons, comment un film pourrait n'avoir qu'un auteur, puisqu'il est de notoriété publique que le cinéma "ne se fait pas seul". Pour eux, un film est la fusion plus ou moins harmonieuse entre divers corps de métier et le réalisateur n'est jamais que celui qui "réalise" les potentialités inscrites dans les noms du générique. Cete vision du cinéma est propre aux moments où l'industrie cinématographique est assez forte pour abriter en son sein — en plus — une véritable exigence artisanale. C'est, en gros, celle de « la profession » toutes les fois que celle-ci se reconnaît et s'auto-plébiscite dans les films ici "césarisables", là-bas "oscarisables".
Les scandalisés du second type, eux, comprennent mal qu'à supposer qu'un film parfois ait un auteur, on puisse affirmer que celui-ci le serait "de droit divin" pour tous ses autres films. Un auteur, c'est quelqu'un d'assez libre pour prendre, seul, de l'écriture du scénario au choix des acteurs, toutes les grandes décisions qui préexistent à la mise en scène. Ou bien c'est un homme et une équipe portés par un mouvement assez puissant — social, politique, esthétique — pour que leur film "reflète" ce mouvement. C'est ainsi que nul n'avait refusé au Lang allemand, au Renoir d'avant-guerre ou au Rossellini néo-réaliste le statut d'auteur. Le scandale, c'est lorsque les jeunes critiques de la Nouvelle Vague prennent tout à fait au sérieux la "période américaine" de Lang ou de Renoir ou les films de Rossellini avec Ingrid Bergman, soit parce que ces films sont des commandes, soit parce qu'ils ressemblent trop à des films de circonstance.
Les scandalisés du troisième type, enfin, ne saisissaient pas pourquoi, tant qu'à étudier les auteurs, on ne se contentait pas de ceux qui l'étaient depuis toujours, ostensiblement et parfois dramatiquement. Le concept d'auteur allait à la limite à une galerie de monstres, trop singuliers pour la machine hollywoodienne qui les avait rejetés, de Griffith à Welles, en passant par Chaplin, Sternberg ou Stroheim. Mieux, il allait comme un gant aux cinéastes qui s'affirmaient dans le cadre de la vieille Europe ébranlée et à moitié détruite. Nul n'a jamais bataillé pour que Bresson, Fellini, Tati ou Antonioni soient reconnus comme "auteurs". A Cannes, en 1960, toute la critique digne de ce nom était avec Antonioni pour L'Avventura. En fait, le vrai scandale des Cahiers jaunes avait été d'aller chercher, au cœur même du cinéma américain de divertissement et loin de toute aura culturelle, les deux cinéastes les moins romantiques du monde, Hawks et Hitchcock, et de dire : ceux-là sont des auteurs et non pas des faiseurs. Le scandale, c'était un peu d'être renoiro-rossellinien et beaucoup d'être "hitchcocko-hawksien". »
« En 1984, "avec le recul", il est permis de penser que c'est la crise du film de série qui libère du même coup des possibilités de films prototypes. Or, quoi de plus prototypique, voire atypique, qu'un film "d'auteur" ? Si bien qu'avec le recul, toujours, on peut dire que les Cahiers jaunes, en lançant leur fameuse politique, n'ont peut-être que parachevé un processus depuis longtemps entamé : la reconnaissance du cinéma comme un art et du cinéaste comme artiste, selon la conception romantique de l'auteur-demiurge-propriétaire de son œuvre qui avait déjà cours en littérature.
Trop totale, cette victoire a toutes les apparences d'une victoire à la Pyrrhus. Généralisé, le mot "auteur" perd, outre son sens, sa valeur polémique et ne scandalise plus personne. Même quand la critique des années soixante se met à fouiller dans l'histoire du cinéma avec la volonté bien arrêtée d'exhumer, au mépris de tout bon sens, d'innombrable "auteurs" méconnus, particulièrement dans le cinéma de série américain, confondant les stylistes, les maniéristes, les petits maîtres avec les vrais auteurs. »
« Entre-temps, ce qui avait disparu, c'était l'interrogation sur ce petit mot, "auteur". Comment le définir ? Etait-ce, tout simplement celui qui signait le film ? Ou celui qui, dans des conditions hostiles, faisait en sorte que son désir — son "désir de cinéma" — triomphe de tous les autres et se les assujettisse ? Ou celui qui est devenu tout pour son film, instigateur, promoteur, scénariste, réalisateur, acteur, attaché de presse ? Ou encore l'artiste salarié d'une institution étatique, comme dans les pays communistes ? Ou le pionnier franc-tireur d'un pays sans cinéma — comme en Afrique — "auteur" par définition d'un film qu'aucune industrie aurait voulu — ou refusé de — faire à sa place ? Un peu de tout cela, sans doute. Mais un peu, seulement.
Puisqu'il est question ici, non du concept d'"auteur" en soi mais de la "politique" des Cahiers d'il y a trente ans, il est possible de hasarder une hypothèse. La voici. Dans un art aussi impur que le cinéma, fait par beaucoup de gens et fait de beaucoup de choses hétérogènes, soumis à la ratification du public, n'est-il pas raisonnable de penser qu'il n'y a d'auteur — c'est-à-dire de singularité — que par rapport à un système — c'est-à-dire à une norme ? L'auteur ne serait pas seulement celui qui trouve la force de s'exprimer envers et contre tous mais celui qui, en s'exprimant, trouve la bonne distance pour dire la vérité du système auquel il s'arrache. Comme Godard le faisait pour Le Mépris ou Hitchcock pour Fenêtre sur cour. Les films d'auteurs nous renseigneraient mieux sur le devenir du système qui les a produits que les produits aveugles du système lui-même. L'auteur serait, à la limite, la ligne de fuite par laquelle le système n'est pas clos, respire, a une histoire. »
Préface de Serge Daney, « Après tout », 1984 (réédition)
« Mais s'ils prisent à ce point la mise en scène, c'est qu'ils y discernent... une organisation des êtres et des choses qui est à elle même son sens, je veux dire aussi bien morale qu'esthétique... Toute technique renvoie à une métaphysique. »
André Bazin, Cahiers du cinéma, numéro 44, février 1955